
En bas des blocs
La banlieue, vue de l'intérieur.
Tous les contenus associés (8)

La Cité des hommes (1/9) : L'arrivée
Un documentaire deSeham Boutata
Il y a 35 ans, ils étaient des enfants, les premiers habitants de Paganini. Ils racontent leur arrivée dans cette cité flambant neuve du XXe arrondissement de Paris.
La Cité des hommes
Seham Boutata a grandi dans une cité populaire de Paris avec des copains "black-blanc-beur-feuj". 20 ans plus tard, elle a retrouvé et longuement interrogé les gars de sa cité. Un feuilleton à plusieurs voix qui raconte avec verve et lucidité les postures, les parcours et les embrouilles propres à un quartier populaire.
A partir du milieu des années 80 et jusqu’au début des années 2000, Seham Boutata habite dans une cité parisienne du XXe arrondissement. Souvent critiquée, fantasmée ou mal considérée, la cité représente pourtant un formidable espace de vie. Véritable ville dans la ville, ses habitants de toutes origines partagent un territoire commun où l’entraide, l’ouverture d’esprit et l’amitié sont des qualités nécessaires pour le « bien vivre ensemble ». Cette expérience a considérablement marquée, enrichie et inspirée la future autrice de documentaires pour France Culture.
Pour sa première collaboration avec ARTE Radio, elle a retrouvé ses anciens voisins et camarades d’école pour qu’ils lui racontent comment ils avaient grandi dans leur cité. Fascinée par la vie des garçons qui occupaient l’essentiel de l’espace, elle a voulu à travers leurs récits faire entendre les valeurs souvent positives qui animent les jeunes des quartiers populaires, tout en questionnant la masculinité de ce territoire.
Les gars de Paga
« Ma cité s’appelait « Paganini », mais pour nous c’était Paga. Une cité de l’Est parisien. Une cité populaire du XXe arrondissement, sortie de terre au milieu des années 80. 20 bâtiments, 600 logements, 2000 habitants, un parc, une école, un cabinet médical, un magasin alimentaire, un coiffeur et deux restaurants. Je suis arrivée à Paga à 6 ans en 85. J’en suis partie à 22 ans en 2001. 15 ans dans l’appartement 73, 7e étage, bâtiment 7.
Vivre à Paga dans ces années-là, selon qu’on soit une fille ou un garçon, ce n’est pas la même chose. A l’extérieur, ce territoire semble exclusivement masculin. Les garçons qui y habitent sont aussi les gardiens de la cité. Des halls au parking, des toits aux caves, ils en détiennent les clés. Ils l’occupent, ils la squattent, la défendent, se battent pour elle… Ils la malmènent mais l’aiment profondément.
C’est cette histoire que racontent Cédric, Charlin, Samir, Robinson, Franck, Madala, Mohamed, Giscard, Tarik, Rodney, Silvio, Guillaume et Kassim. Pendant 9 épisodes, ils évoquent leur arrivée au quartier, leur amitié depuis l’école primaire à l’âge adulte, la mixité des origines et des religions, la petite délinquance, mais aussi les guerres de territoires entre cités pourtant identiques, la « charriance » des vannes et du langage, le rapport compliqué aux filles, le démantèlement de la cité et pour finir l’héritage de cette expérience commune.
Cette série est dédiée à la mémoire de Cédric alias « Timer », celui qui n’avait jamais le temps, et qui nous a quittés prématurément à l’automne 2020. »
Seham Boutata produit des documentaires radiophoniques sur France Culture : « Mon passé composé d’Algérie » (Figures Libres), « Islam sur le divan » (LSD,RTBF, RTS), « Le chant du chardonneret » et « Alger rouge et panthères noires » (Une Histoire particulière), « L’élégance du chardonneret » (Création on air, RTBF, RTS) et quelques Pieds sur terre. Elle est également autrice d’un récit littéraire « La mélancolie du maknine », paru au Seuil en 2020.

Ma cité va parler
Un documentaire deMehdi Ahoudig
Mehdi revient dans la cité de son enfance à Garges-lès-Gonesse (Val d'Oise). Il retrouve ses amis, Français d'origine arabe, et les interroge : qu'est-ce qui a changé en banlieue depuis les années 80 ? Héroïne & islam, hip-hop & Albator : une plongée pleine de verve dans l'histoire intime et politique d'une jeunesse métisse.

Wilfried
Un documentaire d'Isabelle Coutant&Mehdi Ahoudig
Ancien caïd d’une cité de Villiers-le-Bel, en banlieue parisienne, Wilfried parle avec recul de son passé de délinquant, de son enfance, de son quartier… De son désir de s’en éloigner aussi, en achetant un pavillon pas trop loin des barres d’immeuble où il a grandi. C’est au moment où il pensait quitter sa cité que la cité l’a rattrapé. Wilfried Atonga a été tué le 17 mars 2016 dans un bar-tabac de Goussainville. Isabelle Coutant et Mehdi Ahoudig l’enregistraient depuis plus d’un an pour faire son portrait.
De portrait, le documentaire se mue alors en enquête pour comprendre le drame. Les auteurs rencontrent son frère Jean, ex-champion du monde de boxe et animateur d’un club dans le quartier, son autre frère Yvon qui enregistre un rap à sa mémoire, sa femme et mère de ses enfants Sandrine, mais aussi l’avocate de la famille et la journaliste locale du Parisien. L’honneur, l’omerta, la vengeance, l’orgueil, les armes, tels semblent les ingrédients du destin de Wilfried, qui prend des allures de tragédie grecque…
Décembre 2019 : le meurtrier de Wilfried est condamné à 18 ans de prison.
Une enquête signée Isabelle Coutant (les Migrants en bas de chez soi, Seuil) et Mehdi Ahoudig (Prix Europa pour Qui a connu Lolita ? et Poudreuse dans la Meuse).
A retrouver sur la chaîne YouTube ARTE Radio.

Loin de la cité
Un documentaire deNina Almberg
En 1979, Sylvie et Fabienne sont deux ados qui habitent Aulnay-sous-Bois en région parisienne. Elles témoignent dans un film documentaire de Jean-Pierre Gallèpe sur la jeunesse des cités. Pour les deux soeurs, ces années sont celles de l'ennui. Pour la cité, c'est l'apparition de l'héroïne, la dégradation de l'habitat et le départ des ouvriers français vers les banlieues pavillonnaires. Nina Almberg mesure avec elles le chemin parcouru depuis cette archive étonnante.
Remerciements : Jean-Pierre Gallèpe pour son film 'A force, on s'habitue' et Tangui Perron (Périphérie).

Que sont-ils devenus ? (2/4) : Ange
Un documentaire deDelphine Saltel
Ancienne prof dans une banlieue difficile, Delphine Saltel retrouve les élèves qu’elle avait enregistrés au collège et confronte leur voix d’enfant à leur parcours d’adulte. 12 ou 15 ans après leur troisième, que sont devenus les petits caïds et les premières de la classe ? Inattendu, drôle et parfois dérangeant, un podcast documentaire sensible sur l’école, la banlieue et la diversité des destins.
En partenariat avec L’Obs.
2. Ange
Dans mes souvenirs de prof débutante, Ange, c’était la terreur. L’élève que je redoutais de croiser dans le couloir. Un grand gaillard imposant, et un perturbateur qui sabotait mes cours sur le complément d’objet direct. Il a d'ailleurs fini par se faire exclure du collège . Quand je le retrouve, il a 25 ans et un profil de gendre idéal, en CDI et propre sur lui. Comment ça marche, une telle métamorphose ?

Assa (1/6)
Un documentaire deDelphine Saltel
Assa Diakité vit dans une cité de la banlieue parisienne. Delphine Saltel, qui a tenu l'an dernier son 'Journal de prof' sur ARTE Radio a décidé de faire son portrait. Premier épisode : le quartier. Un lieu que la prof et son élève ne voient pas de la même façon.

La Muette
Un documentaire deMehdi Ahoudig
Le quartier de La Muette à Garges, en banlieue parisienne, va être 'réhabilité', et on détruit déjà quelques immeubles. Mais une barre qui s'écroule, c'est aussi de la mémoire qui disparaît. Des habitants s'expriment sur la réhabilitation en cours, le passé et l'avenir de leur ville. Après son documentaire remarqué 'Ma cité va parler', Mehdi Ahoudig poursuit son écoute du 'peuple des banlieues'.
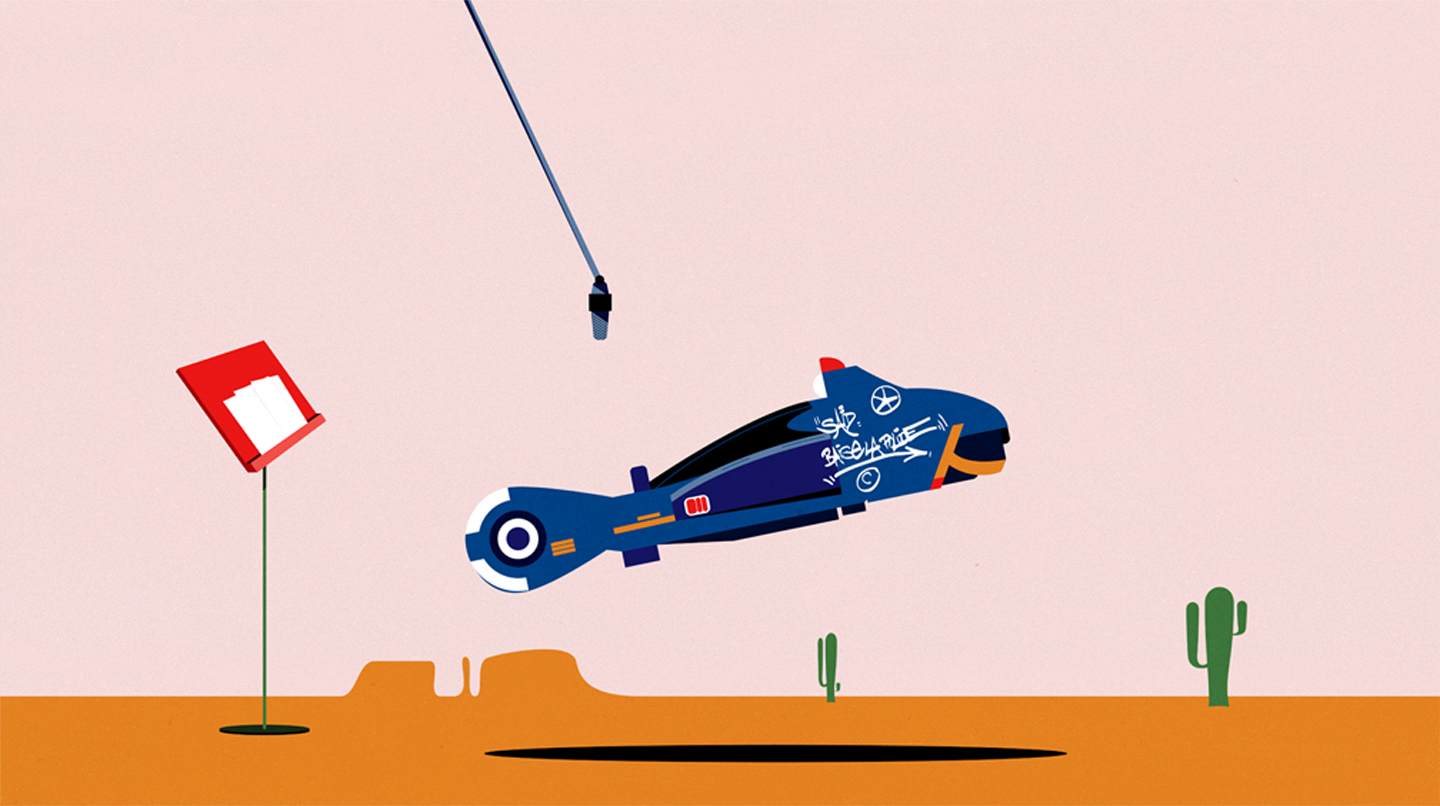
Écouter le cinéma (1/5) : Du vent dans la plaine
Un documentaire deLaetitia Druart
Les ingénieurs du son de La haine, Gravity et Sur mes lèvres dévoilent les bases de la mise en scène sonore. Ils racontent le rôle de l’ambiance au cinéma, expliquent comment le son des films peut raconter une histoire, donner des indices et entrer dans l’inconscient du spectateur pour influencer ses émotions.
Films cités dans l’épisode :
La Môme, Sur mes lèvres, Blade Runner, La Haine, Gravity, Rencontres du troisième type.
Anecdote :
Dans La Haine, toutes les séquences à Paris sont en son mono, et tout ce qui se passe en banlieue est en stéréo. Ce qui donne à la capitale l’effet d’une ville inconnue, confuse et dangereuse pour les banlieusards, quand au contraire leur cité trouve avec un son large et riche une forme de grâce et de profondeur.
Avec :
- Pascal Villard, monteur son et sound designer (Santa & Cie, De rouille et d’os, De battre mon cœur s’est arrêté). César du meilleur son pour La Môme et Sur mes lèvres.
- Guillaume Bouchateau, monteur son et sound designer (Valérian, Les Combattants, Jack et la mécanique du cœur).
- Jean-Stéphane Guitton, compositeur et professeur de musique de film au conservatoire de Paris.
- Anne Le Campion, mixeuse (La jeune fille et la mort, Miss Sloane, Léon...) César du meilleur son pour Tous les matins du monde.
- Nicolas Becker, bruiteur, sound designer et compositeur (Gravity, 127 heures, La Haine, Premier contact...)
Écouter le cinéma
Un podcast sur le son au cinéma, comment on le fabrique et à quoi il sert. Effets, trucages et astuces, les oreilles d’or du cinéma révèlent comment ils créent la bande sonore d’un film. Ils sont bruiteurs, monteurs ou compositeurs, ils travaillent sur des blockbusters de science-fiction ou des films d’auteur, ils adorent leur métier et racontent tout depuis leur studio.